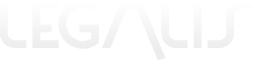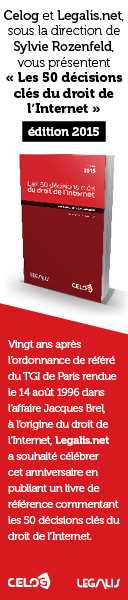Jurisprudence : Responsabilité
Cour de cassation Première chambre civile Arrêt du 12 juillet 2012
Aufeminin.com / Google France
contenu - contrefaçon - filtrage - hébergeur - notification - nouvelle mise en ligne - photographie - surveillance
DISCUSSION
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à l’occasion du festival du film de Marrakech de 2001, M. X…, photographe, a pris plusieurs photographies du chanteur et acteur M. Y…, dont la société H et K, agence de presse, a reçu mandat de leur auteur d’assurer la commercialisation ; que M. X… et la société H et K ont fait constater, le 13 novembre 2008, qu’une de ces photographies était accessible sur Internet sur le site www.Aufeminin.com de la société éponyme et se trouvait reprise par le moteur de recherches Google Images sur le site http://images.google.fr, sans aucune autorisation ; qu’après notification faite à la société Aufeminin.com le 27 novembre 2008 et assignation en référé délivrée le 9 décembre 2008 à l’encontre de la société Google Inc. qui s’était alors engagée à procéder au retrait de la photographie litigieuse, suivie d’une notification faite le 21 janvier 2009 aux sociétés Google France et Google Inc., M. X… et la société H et K ont à nouveau fait constater les 2 janvier, 4 février et 10 mars 2009 ainsi que les 19 mai, 4 juin et 26 novembre 2010, que la photographie était toujours accessible sur les sites évoqués, à partir d’adresses différentes ; qu’ils ont fait assigner la société Google Inc., la société Google France et la société Aufeminin.com aux fins de voir constater l’exploitation contrefaisante de la photographie de M. Y…, de voir ordonner la suppression de cette photographie sur les sites ci-dessus indiqués et d’obtenir réparation de leur préjudice patrimonial et du préjudice moral de l’auteur ; que l’arrêt confirme le jugement notamment en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Google France et a dit que la société Aufeminin.com n’avait pas accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible la remise en ligne de la photographie litigieuse et ne pouvait se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue par l’article 6 I-2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, et, infirmant le jugement quant au fondement de la responsabilité des sociétés Google Inc. et Google France pour retenir que celles-ci n’avaient pas retiré promptement la reproduction de la photographie litigieuse ni accompli les diligences nécessaires pour empêcher une nouvelle mise en ligne de cette œuvre, dit que les trois sociétés ont porté atteinte aux droits moraux et patrimoniaux de M. X…, et condamne, en conséquence, ces mêmes sociétés à indemniser celui-ci de ses préjudices, en interdisant la poursuite de ces agissements sous astreinte ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Google Inc. et de la société Google France
Attendu que les sociétés Google Inc. et Google France font grief à l’arrêt de maintenir cette dernière dans la cause et de la condamner, in solidum avec la première et avec la société Aufeminin.com, à payer diverses sommes à M. X… en réparation de ses préjudices, moraux et patrimoniaux, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en retenant, pour justifier le maintien dans la cause de la société Google France, qu’il ressortait des procès-verbaux de constat dressés par l’APP que la société Google France apparaissait comme étant le bureau français à contacter de la société Google Inc., quand la simple mention des coordonnées de la société Google France ne suffisait pas à caractériser sa participation directe et effective aux faits litigieux, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ qu’en se fondant, pour justifier le maintien dans la cause de la société Google France, sur le seul objet statutaire de ladite société quand la participation personnelle et effective de la société Google France à la commission des faits objets du litige devait être appréciée à la lumière de ses activités réelles, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ qu’en retenant pour justifier le maintien dans la cause de la société Google France, le fait que cette société réalise des opérations commerciales pour faciliter et développer l’exploitation du réseau Google, ce dont il se déduisait qu’elle intervenait tout ou plus dans la vente de service payants et non dans l’exploitation de services gratuits tels que le service Google Images quand les termes du litige imposaient, pour que la société Google France y soit impliquée, que celle-ci participe de manière effective à la fourniture aux utilisateurs du service Google Images d’un accès à des images indexées reproduisant tout ou partie des œuvres de M. X…, la cour d’appel qui n’a pas caractérisé une telle participation effective a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;
4°/ qu’en traitant indifféremment les situations des sociétés Google Inc. et Google France pour les condamner in solidum à payer différentes sommes à M. X… en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à ses droits patrimoniaux et à son droit moral, tout en relevant que la société Google Inc. était propriétaire du site Google.fr et revendiquait la responsabilité du fonctionnement du service gratuit d’indexation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que la cour d’appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la reproduction de la photographie litigieuse se trouvait sur le site accessible à l’adresse http://images.google.fr, que la société Google France était présentée comme le bureau français de la société Google Inc. à contacter et qu’elle exerçait une activité de fournitures de services, en des textes rédigés en français et destinés au public français ; que de l’appréciation souveraine de l’ensemble de ces éléments, elle a pu déduire la participation directe et effective au fonctionnement du service gratuit d’indexation mis en œuvre par la société Google Inc. de la société Google France dont la responsabilité a été retenue pour n’avoir pas accompli les diligences nécessaires après les notifications qui lui avaient été faites par M. X… ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi
Attendu que les sociétés Google reprochent à l’arrêt de déclarer la loi française applicable au litige, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en application de l’article 5 § 2 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, la loi applicable aux agissements litigieux est celle du pays où la protection est réclamée qui n’est pas celle du lieu où le dommage est subi mais celle du pays sur le territoire duquel se sont produits les agissements ; qu’en l’espèce, statuant sur la contestation relative à la loi applicable au litige, la cour d’appel a dit la loi française applicable en retenant que le litige porte sur le fonctionnement des services Google Images, rédigés en français, destinés au public français et accessibles en France par les adresses URL en « .fr », que l’internaute pourra ainsi visualiser en France la photographie de M. X… et au besoin la télécharger, que cette photo a été mise en ligne et stockée sur plusieurs sites français, que la société Aufeminin.com, dont la responsabilité est également recherchée, est une société dont le siège est à Paris, qu’il suit que le lieu de destination et de réception des services Google Images et de connexion à ceux-ci, caractérisent un lien de rattachement substantiel avec la France qui commande l’application de la loi française ; qu’en se prononçant ainsi, lorsque la loi applicable au litige devait être déterminée par application de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, la cour d’appel a violé l’article 5 § 2 de ladite Convention ;
2°/ qu’en application de l’article 5 § 2 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, la loi applicable aux agissements litigieux est celle du pays où la protection est réclamée qui n’est pas celle du lieu où le dommage est subi mais celle du pays sur le territoire duquel se sont produits les agissements ; qu’en retenant, pour décider que la loi française était applicable, que le fonctionnement des services Google Images, rédigés en français, destinés au public français et accessibles en France par les adresses URL en « .fr », que l’internaute pourra ainsi visualiser en France la photographie de M. X… et au besoin la télécharger, que le lieu de destination et de réception des services Google Images et de connexion à ceux-ci caractérisaient un lien de rattachement substantiel avec la France, la cour d’appel a violé l’article 3 du code civil ensemble l’article 5 § 2 de la Convention de Berne ;
3°/ qu’en application de l’article 5 § 2 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, la loi applicable aux agissements litigieux est celle du pays où la protection est réclamée ; qu’en retenant, pour justifier l’application de la loi française, que la société Aufeminin.com, dont la responsabilité est également recherchée, est une société dont le siège est à Paris quand le lieu du siège social du codéfendeur n’a aucune incidence sur la loi applicable aux actes litigieux, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles 3 du code civil et 5 § 2 de la Convention de Berne ;
Mais attendu que l’arrêt retient que le litige porte sur le fonctionnement des services Google Images, en des textes rédigés en français, destinés au public français et accessibles sur le territoire national par les adresses URL en “.fr” et que le lieu de destination et de réception des services Google Images et de connexion à ceux-ci caractérisent un lien de rattachement substantiel avec la France ; qu’il en déduit exactement, conformément à l’article 5.2 de la Convention de Berne qui postule l’application de la loi de l’Etat où la protection est réclamée, que l’action introduite par M. X…, qui réclamait, en tant qu’auteur de la photographie, la protection de ses droits en France à la suite de la constatation en France de la diffusion en France, par un hébergeur français, la société Aufeminin.com, d’une photographie contrefaisante, mise en ligne pour le public français sur le site de Google Images par le service des sociétés Google Inc. et Google France, relevait de la loi française ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses quatre premières branches
Attendu que les sociétés Google Inc. et Google France font grief à l’arrêt de dire qu’en tant qu’exploitantes du moteur de recherche sur le site accessible à l’adresse http://images.google.fr, elles n’avaient pas retiré promptement la reproduction de la photographie représentant M. Y…, prise par M. X… au festival de Marrakech en 2001, de sorte qu’elles ne pouvaient se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l’article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 modifiée par la loi du 9 juillet 2010, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge est tenu d’observer et de faire observer le principe de la contradiction ; qu’en relevant d’office le moyen tiré de l’application de l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 aux sociétés Google Inc. et Google France sans soumettre ce moyen à la discussion contradictoire des parties, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que les sociétés avaient fait valoir dans leurs conclusions d’appel que leur activité relevait de l’article 9 de la loi du 21 juin 2004 devenu l’article L. 32-3-4 du code des postes et communications électroniques et de l’article 13 de la directive du 8 juin 2000 ; qu’ainsi, les sociétés montraient qu’elles réalisaient exclusivement un stockage temporaire dit caching et devaient être à ce titre soumises à un régime de responsabilité spécifique ; qu’en s’abstenant de répondre à de telles écritures déterminantes pour l’issue du litige, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 tel qu’interprété à la lumière de l’article 14 de la directive du 8 juin 2000 s’applique exclusivement aux hébergeurs c’est-à-dire aux personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ; qu’en faisant application de ce texte aux sociétés Google Inc. et Google France lorsque celles-ci, en leur qualité de moteur de recherche, ne réalisaient aucun hébergement mais seulement une opération de caching dans le cadre d’une activité de moteur de recherche, la cour d’appel a violé le textes susvisé ;
4°/ que la notification délivrée au visa de la loi du 21 juin 2004 doit comporter l’ensemble des mentions prescrites par ce texte, en particulier la description des faits litigieux et leur localisation précise ainsi que les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et les justifications de fait, et ce afin que l’opérateur dispose de tous les éléments nécessaires à l’identification du contenu et à la justification de son caractère illicite ; qu’en se bornant à retenir que M. X… avait fait connaître aux sociétés Google, en notifiant le 8 décembre 2008 le premier constat du 28 novembre puis le 21 janvier 2009, le second constat en date du 2 janvier, sa volonté de ne voir indexer aucun site reprenant sa photographie, pour retenir que les sociétés Google avaient été en mesure de procéder au retrait des contenus signalés sans s’assurer que les notifications délivrées étaient suffisamment précises et respectaient les prescriptions de l’article 6.I.5 de la loi du 21 juin 2004, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu, d’abord, que, la cour d’appel, en considération de la nature du service fourni et des faits incriminés, a, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, fait application aux sociétés Google, en tant que prestataires de services de référencement sur internet, des dispositions de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004, mises dans le débat par les écritures de M. X…, après avoir constaté que ces sociétés avaient procédé à la réduction de la photographie litigieuse sous forme de vignette et que celle-ci demeurait stockée sur le site de Google Images, où elle pouvait faire l’objet d’un agrandissement, au-delà et indépendamment des strictes nécessités d’une transmission, constatations qui excluaient la qualification retenue par l’article L. 32-3-4 du code des postes et des communications électroniques, répondant ainsi à leur argumentation prétendument négligée ; qu’ensuite, les sociétés Google, en contestant, devant la Cour de cassation, la validité des notifications des 8 décembre 2008 et 21 janvier 2009, invoquent une thèse contraire à celle soutenue devant les juges du fond, faisant valoir qu’elles avaient retiré promptement les contenus litigieux des adresses dès qu’elles en avaient eu connaissance, ce qui implique que les notifications, maintenant contestées, avaient été suffisamment précises et respectaient les prescriptions de l’article 6.I.5 de la loi du 21 juin 2004 ; que le moyen, en ses trois premières branches mal fondées et en sa quatrième irrecevable, ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen du même pourvoi
Attendu que les sociétés Google Inc. et Google France reprochent à l’arrêt de statuer comme il le fait, alors, selon le moyen :
1°/ que la présentation d’une œuvre au public, lorsqu’elle est accessoire par rapport au sujet principal traité doit être considérée comme une inclusion fortuite échappant au monopole de l’auteur ; qu’en estimant que les sociétés avaient commis des actes de contrefaçon pour avoir reproduit la photographie litigieuse sur le service Google Images, sans rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant expressément invitée par les sociétés, si la présentation de chaque vignette litigieuse indexée n’était pas accessoire par rapport à l’objet du service Google Images, à savoir le référencement aussi exhaustif que possible d’images disponibles sur Internet et répondant aux requêtes des internautes, et partant, si son inclusion au sein des pages de résultats n’était pas fortuite, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l’article 5-3 i) de la Directive 2001/CE du Parlement et du Conseil du 22 mai 2001 ;
2°/ que la reproduction d’une photographie sous forme de vignettes, lorsqu’elle est strictement nécessaire au fonctionnement d’un moteur de recherche, ne constitue pas un acte de contrefaçon ; qu’en estimant que les sociétés avaient commis des actes de contrefaçon pour avoir reproduit la photographie litigieuse sur le service Google Images, sans rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant expressément invitée par les sociétés Google, si la reproduction de photographies sous forme de vignettes n’était pas strictement nécessaire au fonctionnement du moteur de recherche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l’article 5-2 i) de la Directive 2001/CE du Parlement et du Conseil du 22 mai 2001 ;
3°/ que les sociétés Google faisaient expressément valoir dans leurs conclusions en cause d’appel que le recadrage des photographies ne leur était pas imputable, mais était le seul fait des éditeurs des sites Internet qui sont à l’origine des mises en ligne initiales ; qu’en estimant que les sociétés Google avaient porté atteinte au droit moral de l’auteur par le recadrage des photographies, sans répondre aux conclusions déterminantes des sociétés sur l’origine du recadrage, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que ne constitue pas une atteinte au droit moral de l’auteur d’une photographie la réduction de l’image à la taille de vignette dès lors qu’une telle réduction, inhérente au fonctionnement d’un moteur de recherche, est nécessaire au droit du public à l’information ; que les juges du fond, qui ont relevé l’atteinte au droit moral dans la réduction des photographies litigieuses, sans rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant expressément invitée par les sociétés, si une telle réduction n’était pas nécessaire au fonctionnement du moteur de recherche et à l’information de l’internaute, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
5°/ que l’opérateur d’un moteur de recherche qui référence automatiquement une image hébergée sur un autre site, la mentionne sur une page de résultats sous la forme d’une vignette dotée d’une fonction hypertexte et permet, en cas de clic sur celle-ci, de visualiser l’image dans une fenêtre connectée au site hébergeur, ne réalise lui-même aucune contrefaçon des œuvres reproduites au sein de l’image dès lors que, une fois mis en connaissance du caractère manifestement contrefaisant de l’image, il agit promptement pour retirer le lien permettant d’y accéder ; qu’en l’espèce, les sociétés Google faisaient valoir dans leurs écritures que la société Google Inc. avait, dans un bref délai, procédé au déréférencement des liens indexés ; qu’en ne recherchant pas si ces retraits successifs opérés par la société Google Inc. n’étaient pas de nature à exclure l’imputation aux sociétés Google d’un acte de représentation illicite des images en cause, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-2 et L. 215-1, ensemble des articles L. 335-3 et 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel n’avait pas à se livrer aux recherches prétendument omises dès lors que, d’une part, la notion “d’inclusion fortuite dans un autre produit”, retenue par les dispositions invoquées de la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, doit s’entendre comme une représentation accessoire et involontaire par rapport au sujet traité ou représenté, ce qui n’était pas le cas de la réduction de la photo sous forme de vignette, et non par rapport à une activité ou à une prestation de services, et que, d’autre part, la responsabilité des sociétés Google a été retenue pour avoir manqué à leur obligation de retirer promptement les images contrefaisantes aussitôt après avoir reçu notification de ses droits par l’auteur ; qu’ensuite, l’arrêt fonde l’atteinte portée au droit moral de l’auteur par les sociétés Google sur l’absence de mention de son nom et sur la réduction de la photographie sous forme de vignette, de sorte que la cour d’appel n’avait pas à se livrer à une recherche, au demeurant demandée au seul soutien de l’invocation du “caching”, rendue vaine par la nécessaire protection des droits de l’auteur ; que le moyen, inopérant en ses quatre premières branches et qui, en sa cinquième, ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond quant à l’absence de promptitude des sociétés Google à opérer le retrait des images contrefaisantes, ne peut qu’être rejeté ;
Sur le moyen unique de la société Aufeminin.com en ce qu’il est dirigé contre la disposition la condamnant à payer deux sommes de 10 000 € en réparation des préjudices de M. X…, tel qu’il figure en annexe
Attendu que les griefs articulés par le moyen sont étrangers à cette disposition ; que, comme tels, ils sont inopérants ;
Mais, sur le troisième moyen, pris en ses quatre dernières branches, du pourvoi des sociétés Google, et sur le moyen unique du pourvoi de la société Aufeminin.com
Vu l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 en ses dispositions I.2, I.5 et I.7 ;
Attendu que, pour refuser aux sociétés Aufeminin.com, Google Inc. et Google France le bénéfice des dispositions du texte susvisé et leur faire interdiction de poursuivre les agissements incriminés sous astreinte, l’arrêt retient que, dûment informées des droits de M. X…, elles n’ont pas pris les mesures utiles de nature à prévenir de nouvelles mises en ligne de la photographie litigieuse et qu’il importe peu que cette photographie soit accessible à partir d’une adresse différente de celle portée dans le constat du 28 novembre 2008 dès lors qu’il incombe au prestataire de services d’hébergement ayant reçu notification de l’œuvre à laquelle il est porté atteinte et des droits de propriété intellectuelle qui la protègent de prendre les mesures nécessaires pour empêcher qu’elle soit à nouveau mise en ligne ;
Qu’en se prononçant ainsi, quand la prévention et l’interdiction imposées à la société Aufeminin.com, en tant qu’hébergeur, et aux sociétés Google, en tant que prestataires de services de référencement, pour empêcher toute nouvelle mise en ligne de l’image contrefaisante, sans même qu’elles en aient été avisées par une autre notification régulière pourtant requise pour qu’elles aient effectivement connaissance de son caractère illicite et soient alors tenues d’agir promptement pour la retirer ou en rendre l’accès impossible, aboutit à les soumettre, au-delà de la seule faculté d’ordonner une mesure propre à prévenir ou à faire cesser le dommage lié au contenu actuel du site en cause, à une obligation générale de surveillance des images qu’elles stockent et de recherche des reproductions illicites et à leur prescrire, de manière disproportionnée par rapport au but poursuivi, la mise en place d’un dispositif de blocage sans limitation dans le temps, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées ;
DÉCISION
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le cinquième moyen du pourvoi des sociétés Google ni sur le sixième moyen du même pourvoi qui n’est pas de nature à en permettre l’admission :
. Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a dit que la société Aufeminin.com et les sociétés Google Inc. et Google France n’avaient pas accompli les diligences nécessaires pour empêcher la remise en ligne de la photographie de M. Y… dont M. X… était l’auteur, en ce qu’il a dit que ces sociétés ne pouvaient se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l’article 6.2 de la loi du 21 juin 2004 pour les remises en ligne constatées, en ce qu’il condamne les sociétés Google Inc. et Google France à indemniser M. X… de ses préjudices, moraux et patrimoniaux, au titre des remises en ligne de son œuvre et en ce qu’il a interdit la poursuite des agissements incriminés sous astreinte, l’arrêt rendu le 4 février 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.
La Cour : M. Charruault (président), M. Galle (conseiller)
Avocats : SCP Delaporte, Briard et Trichet ; Me Le Prado ; SCP Lyon-Caen et Thiriez
Notre présentation de la décision
En complément
Maître Briard et Trichet est également intervenu(e) dans les 12 affaires suivante :
En complément
Maître Fabiani et Thiriez est également intervenu(e) dans les 15 affaires suivante :
En complément
Maître Le Prado est également intervenu(e) dans les 10 affaires suivante :
En complément
Maître SCP Delaporte est également intervenu(e) dans les 12 affaires suivante :
En complément
Maître SCP Lyon-Caen est également intervenu(e) dans les 18 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Charruault est également intervenu(e) dans les 47 affaires suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.